









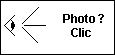
Quelle photo de ton père ?
Quel texte ?
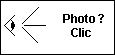
Michel Truttmann au cours de son hommage
Pour te rendre ce dernier hommage, évoquons d’abord tes origines.
Né en 1934 d’une famille lorraine enracinée depuis plusieurs siècles dans la terre de VITTEL et de ses environs, tu vas être toute ta vie habité par l’histoire et les traditions de ces marches de l’Est que tu connais bien : le pays Lorrain.
Ton grand-père lui-même y était médecin et parcourait tous les villages des alentours avec sa carriole, à la fin du 19ème siècle. Il fit construire cette grande maison, rue de Verdun en 1862. Ton père René, qui a terminé général, était d’une famille d’officiers et épousa Suzanne CLAUDEL, fille du docteur CLAUDEL. Il eut 3 fils : Jean, François (8 ans et ½ de moins) , et toi le petit dernier, mais la grande différence d’âge entre vous fit que tu n’eus pas souvent l’occasion de jouer avec eux.
De cette enfance, sous le sceau des valeurs, de la tradition et de la rigueur, tu garderas le sens propre à cette terre, de la simplicité, du goût de l’effort, de l’attachement à l’essentiel au détriment de l’accessoire. Souvent seul avec ta mère, tu vivras en 1944 des moments parfois difficiles alors que ton père était envoyé à Neuengame depuis le printemps et que ton frère Jean fut grièvement blessé au sein de la 2ème DB.
Mais, après la guerre, voici que ton engagement t’amène à concrétiser ton goût pour la carrière des armes – comme ton père (promotion Grande Revanche) et ton oncle ainsi que ton frère aîné (promotion Maréchal Pétain). Tandis que ton frère François, après des études au Prytanée Militaire de la Flèche, choisit une carrière d’ingénieur, tu prépares Saint Cyr au lycée Poincaré de NANCY et tu intègres la promotion « Ceux de Dien Bien Phu ».
D’un caractère entier, droit dans tes rangers, tu feras une carrière militaire honorable, sans compromission et sans jamais renier tes convictions, même face à des interlocuteurs très étoilés. Après, le Génie de l’Air et la guerre d’Algérie (barrage fortifié électrique Ligne Morice), tu suivras une carrière essentiellement Génie Travaux et tu termineras Major de garnison à TOUL en 1985.
Elle est venue très tôt : adolescent, tu sillonnais en vélo les routes lorraines de Metz à Epinal puis la Ligne Maginot, dans le but de découvrir ces hauts lieux de l’histoire lorraine, tu dessinais déjà admirablement.
Ayant épousé Bernadette CAILLOUX, qui t’a donné 3 enfants, tu l’as entraînée pendant 30 ans au coeur même des forts et ouvrages. Elle t’y suivra avec passion et abnégation.
Dès 1965, à l’Ecole Supérieure Technique du Génie de Versailles, tu as la particularité d’être à la fois capitaine élève et professeur de fortifications.
Tu te bats pour faire conserver 4 kilomètres de Ligne Maginot à Bitche et tu fais réarmer le SIMSERHOF avec ses stocks de 1940 à titre d’exemple.
Tu emmènes plusieurs années de suite les officiers en Lorraine ou à Nice pour bien faire comprendre l’art de la défense.
Puis ta carrière t’amène ailleurs. Chose rare, tu es expert accrédité auprès des affaires culturelles et tu dispenses des cours d’architecture militaire aux architectes diplômés DPLG au Palais de Chaillot.
Chef du génie à Thionville, tu hérites de 2000 hectares de forts abandonnés de la Ligne Maginot que tu sauveras longtemps des premiers pillages, malgré la modestie des moyens dont tu disposes.
Tu obtiendras de l’armée la cession du Hackenberg au village et ce fort deviendra en quelques années l’un des fleurons du tourisme militaire.
Peu après, tu passes une thèse de doctorat de 3ème cycle et tu publieras sous le titre « la Muraille de France », rééditée 5 fois à ce jour, et dont Mr Pierre JOXE, Ministre de la Défense, dira : « C’est une somme ».
Te consacrant ensuite à Séré_de_Rivières, tu inventories tous ses forts et batteries de Dunkerque à Menton, toujours en jeans et baskets, au volant de ton camping-car.
Tu publies alors « la Barrière de fer », bourrée de dessins en « 3D » faits au Rotring, ta seconde oeuvre majeure.
Tes conférences t’amènent à côtoyer des ministres et ambassadeurs, américains, chinois, britanniques. Tu reçois des milliers de courriers du monde entier, auxquels tu réponds aussitôt.
Mais, c’est au plan local que tu décides de t’investir sur les dernières années. Tes conseils avisés permettront la restauration des forts d’Uxegney et de Bourlémont.
Mais depuis quelque temps, tout s’est ralenti. Grand fumeur depuis 50 ans, vivant seul, tu t’éteins brutalement ce 7 décembre dans cette grande maison de famille que tu ne voulais plus quitter.
Nous te connaissons, tu nous as quittés selon tes convictions, où et comme tu le souhaitais, car tu refusais obstinément l’assistanat.
Ton oeuvre, te survivra, tes archives seront un jour mises à la disposition des chercheurs de plus en plus nombreux aujourd’hui qui, tous, connaissent ton nom.
Mon cher papa, devant ta famille et tes amis, devant tes frères d’armes et tes camarades, tes enfants te disent ADIEU.
Michel TRUTTMANN 7 décembre 2007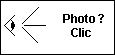
Photo peut-être de la couverture de la muraille de France :
"Ces forteresses autour desquelles s'est bâtie la France" (1967 Archéologie n°16-17-18)
"La France de Vauban" (1970 Agenda Kodak)
"La Ligne Maginot - conception -réalisation" (1974 sous le pseudonyme de Louis Claudel)
"Fortification, architecture et urbanisme aus XVIIe et XVIIIe siècle" (1976 Thionville)
"Prestige des ingénieurs militaires du Grand Siècle" (1977 EAG)
"L'architecture militaire en Franche_compté" (1978 Revue des MH)
"Vocabulaire d'architecture" (Participation à ce document de l'Imprimerie Nationale)
"Cantons de l'Ile_de_Ré" (1979 Participation à ce document inventaire de l'Imprimerie Nationale)
"Cantonade Belle_Ile_en_Mer" (1979 Participation à ce document inventaire de l'Imprimerie Nationale)
"Monographie de la forteresse de Salses" (1980 ????)
"Toul" ????
"La Muraille de France" (1985 Editions Klopp)
"La barrière de fer" (2000 Editions Klopp)
Préface de "Histoire de la fortification" (????)
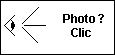
Maréchal Pétain : il mène les débats du CSG plus en chef qui impose qu'en responsable qui propose.
La suite des débats, encore plus houleuse, devient presque orageuse car le Maréchal Pétain pose la question de la nature des travaux à réaliser. A l'évidence il a déjà opté pour une solution précise puisqu'en guise de conclusion il ajoute, non pas au conditionnel mais au futur :
Cette affirmation plus politique que militaire fait bondir le Maréchal Joffre qui ne peut pas admettre que le système de fortification dépende uniquement du Plan d'Opérations car, rappelle-t-il, le Plan peut changer avec la situation. Pétain rétorque bien qu'en l'état actuel des choses on peut presque indiquer à l'avance les points sur lesquels les armées seront sur la défensive, comme celui de Longwy par exemple, mais le Maréchal Joffre n'en démord pas :
Le Maréchal Pétain ne peut que céder à ces arguments, tout comme le Président de la République qui demande alors l'avis du Conseil sur la nécessité ou non de réaliser des travaux de fortification permanente.
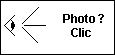
André Maginot : un ministre ici dépassé par la terminologie, ou politiquement réservé ?
Pour répondre à la question, sur la nécessité ou non de réaliser des travaux de fortification [permanente] il importe de se mettre d'accord sur ce qu'est une fortification. Aussi le débat qui semblait s'être calmé est de nouveau animé, tout particulièrement sur la distinction entre fortification permanente et fortification de campagne. Et la pièce jouée autour des hommes politiques, qui semblent dépassés par la terminologie, peut s'interpréter ainsi :
Le Président de la République :
Le Général Hellot :
Le Président de la République :
Le Général Debeney :
Le Président de la République :
Le Maréchal Pétain :
Le Général Buat n'est pas de cet avis :
Le Maréchal Pétain :
Le Général Guillaumat approuve :
Le Président de la République en revient à sa question :
Le Général Guillaumat :
Le Président de la République :
Le Général Buat :
Le Général Debeney n'est pas d'accord avec son homologue :
Depuis pas mal de minutes le Ministre de la Guerre semble être mis hors jeu par les spécialistes qui débattent et, devenu simple spectateur, il ne se risque plus à émettre un quelconque avis. Seul le Président de la République tente de reformuler régulièrement sa question, mais en vain dès lors qu'il prononce les mots fatidiques de permanente ou de campagne ! Aussi, en fin politique, finit-il par modifier les termes de sa question :
Le débat est alors recentré. Mais comme les Maréchaux Joffre et Pétain échangent de nouveau, et longuement, leurs points de vue divergents sur la question de ligne continue ou non le long de la frontière, le Maréchal Foch coupe court estimant que :
Le Général Berthelot partage cet avis ; le Maréchal Pétain propose de confier l'étude des questions relatives à l'organisation défensive du territoire à une Commission à créer ; cette proposition est mise aux voix par le Président de la République ; elle est adoptée et la séance est levée.
Dans les cartons du CSG, la CDT (Commission de Défense du Territoire) vient d'être conçue et, selon toute vraisemblance, une nouvelle fortification se profile à l'horizon !
Cette séance du CSG, du 22 mai 1922, permet de faire les constats suivants :
C'est un concept essentiellement politique et démagogique. Au lendemain de la Grande Guerre, l'opinion publique, lasse des massacres, ne peut qu'être attirée par cette voie qui privilégie la défensive ; les politiques s'y engouffrent.
Pour la plupart des militaires, cette inviolabilité passe mal car elle conduit à immobiliser et scléroser les armées alors que les guerres ne se gagnent que par l'innovation et le mouvement.
Quant au Maréchal Pétain, il est d'autant plus favorable au concept d'inviolabilité qu'il y voit un moyen d'associer défense nécessairement puissante et mouvement. En effet, en 1916 il a personnellement tenu Verdun en défensive. Et il ne l'a pas fait par manque de fougue militaire mais en attendant d'avoir une armée suffisamment forte pour être efficace dans l'offensive.
Les fortifications coûtent très cher. Et même si du matériel de guerre mobile coûte aussi cher, ce dernier a l'avantage de pouvoir être transporté où le besoin s'en fait sentir, contrairement à la fortification dont les dépenses semblent souvent se faire en pure perte.
Il importe donc de ne fortifier qu'à bon escient. Et l'on se trouve devant un deuxième problème qui divisera lui aussi les hommes (et tout particulièrement l'armée) des années 30 : où fortifier ? Comment fortifier ?
Pour quelle cause nationale que ce soit, pourquoi la décentralisation en 2007 donnerait-elle de meilleurs résultats qu'en 1935 ?
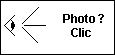
Comme dans tous les domaines spécialisés, chaque définition peut être déclinée à l'infini ou réduite à son strict minimum. Celle de la fortification n'échappe pas à la règle. Sans aller chercher très loin dans le temps, si l'on se réfère au cours de fortification du capitaine du Génie Bailly (1875) on constate qu'il définit 3 types de fortification : la permanente, la passagère et la provisoire (appelée aussi mixte ou demi-permanente). Il ne fait pas un état explicite de la fortification de campagne.
Sans vouloir jouer les spécialistes nous allons schématiser le problème pour le clarifier, d'autant plus que le contenu des définitions a eu une incidence non négligeable sur la construction, et surtout l'évolution, de la Ligne Maginot.
De façon schématique, d'après le capitaine Bailly, on peut dire que la fortification est passagère ou provisoire lorsqu'elle est édifiée en temps de guerre (c'est ce qu'au cours du CSG du 2 mai 1922, on nomme fortification de campagne) et qu'elle est permanente lorsqu'elle est construite en temps de paix (et supposée l'être avec de gros moyens).
Et si, en temps de paix, on fait de la fortification avec de très faibles moyens, comment l'appelle-t-on ? Et si, comme à Verdun en 1916, on fait de la fortification avec de gros moyens ? Et si...
Comme le dit le Maréchal Pétain, le 2 mai 1922 : peut-être devrait-on changer les définitions !
Dans son livre intitulée : La Muraille de France, le Lt-colonel Philippe Truttmann nous donne une clé d'interprétation de la nouvelle terminologie :
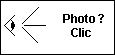
Schéma simplifié de l'évolution négative de la Ligne Maginot.
En 1927, la controverse entre fortification permanente, coûteuse mais puissante, et fortification de campagne, facile à mettre en oeuvre à faible coût [mais souvent de faible rendement], prend momentanément fin. Les hommes politiques tranchent. On édifiera une fortification permanente dans trois régions précises (3 régions fortifiées : Metz, Lauter, Belfort) et, par ailleurs, on mettra en place une fortification de campagne, au travers de laquelle l'armée manoeuvrera.
Le projet de la future Ligne Maginot est ainsi arrêté.
Mais c'était sans compter avec les tenants de la fortification uniquement de campagne qui reviendront à la charge régulièrement, entre autres à chaque réduction budgétaire et à chaque retard de construction. Si bien qu'à partir de 1935, gagnant la partie, ces derniers orienteront la Ligne Maginot vers le tout campagne, la faisant basculer vers une fortification camelote (comme l'écrit le Lt-colonel Philippe Truttmann).
La fièvre bétonite aiguë s'empara alors de la France où l'on construisit, en lieu et place d'un armement mobile, des centaines de blockhaus hétérogènes dont souvent seul l'aspect extérieur donnait l'illusion de la puissance des productions initiales de la Ligne Maginot.
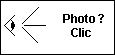
Photo de l'une des deux entrées de l'Avant-Poste de Pierre-Pointue. L'entrée est de face, encadrée par deux baraques du casernement extérieur, utilisé en l'absence d'attaque.
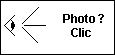
Cette photo de l'équipage du Pont-St-Louis a été prise le 25 juin 1940 aux alentours de leur casemate qu'ils ont défendue jusqu'au bout. Photo Lucien ROBERT.
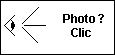
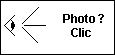
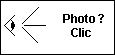
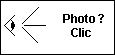
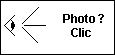
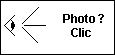


 alt="">
alt="">
Présentation
Hommage de ses enfants au cours de la cérémonie du ???????
Ensemble des travaux et publications de Philippe Truttmann
Doit-on fortifier ?
Pièce, en un acte, jouée par des militaires animés, un Président diplomate et un ministre muet.
Enseignements prophétiques de cette séance du CSG.
Fortification permanente, fortification de campagne... quelles sont les différences ?
Finalement qui va l'emporter, la fortification permanente ou la fortification de campagne ?
Clic : prend l'objet pour le déplacer
Clic : affiche les fichiers locaux
Clic : affiche / efface les repères des légendes
Clic : affiche l'ensemble des fichiers du site
Clic : augmente la taille de l'image
Clic : diminue la taille de l'image
Clic : ferme la fenêtre
Clic : déplace le centre de rotation et de zoom de la maquette
Clic : lâche l'objet
Clic : fait tourner la maquette
Clic : fixe la maquette
Clic NON actif
Clic ACTIF
Clic : affiche le lexique du site, dans une autre fenêtre
Clic : modifie la dimension de la fenêtre
Clic : recule d'une photo
Clic : avance d'une photo
Clic : pause
Clic : avance automatique en continu
Clic : animation
Ligne Maginot : Hommes qui ont marqué son histoire ; Document réalisé à partir d'éléments d'origines diverses transmis par son fils (et notre ami) Michel Truttmann, que nous remercions vivement. E. et R.Cima ©2007-2008
0, Fichiers locaux; 1, Introduction; 2, Hommage; 3, Publications